Vous êtes ici
Dirge + Rosetta 04/11/2013 @ l’Espace B, Paris

Ou pourquoi il faut lire la presse metal. Je n’ai jamais beaucoup aimé vous parler de moi. J’ai toujours pensé, et je le pense encore, qu’un reportage, quand bien même de la part d’un journaliste metal, se doit d’être raconté à la première personne du pluriel et non du singulier. Écrire “Je” le moins possible. Parce qu’une publication, c’est une équipe. Que l’engagement est collectif (ligne éditoriale, ton, angles…). Et que le journalisme gonzo n’est plus que l’ombre de ce qu’il était, une mode d’écriture branchouille pour rédacteur plus rompu à l’ego-trip puant qu’au journalisme.
Aujourd’hui c’est un peu spécial : ce que vous lisez est sans doute mon dernier article pour Pelecanus – et pour toute autre publication metal – avant un long moment. Alors je vais vous parler un peu du concert, puisque c’est pour ça que vous avez. Mais je vais vous parler un peu de moi aussi.
Tiens, d’ailleurs. “Journaliste metal”. Chouette association sémantique, non ? Quand j’ai compris que les deux mots pouvaient cohabiter sans s’insulter, il y a près de dix ans, je n’ai pas hésité longtemps avant de m’y plonger. Après tout, le seul équipement dont j’avais besoin, c’était d’un logiciel de traitement de texte, d’un peu de passion et de beaucoup de temps. Et du temps, à l’époque, j’en disposais énormément.
Outta time man
Aujourd’hui, à mon regret, si ma version de Word Office tourne parfaitement, je n’ai plus assez de temps à consacrer à cette activité. Et cela même si ma flamme de metalhead, intacte, brûle toujours d’une lueur menaçante.
Tout semblait pourtant indiquer que ça ne s’arrêterait jamais. Les signes étaient toujours là : mon amour pour l’écriture et la musique, la possibilité d’assister plus ou moins gratuitement à une offre variée de concerts - ça compte, oui. Mais aussi l’équipe de rédacteurs et de photographes, corporation soudée, chaleureuse et dévouée corps et âme à une même passion : la scène. De ce petit groupe de hérauts découle les nécessaires diffusion, relai, critique, analyse et publication autour des musiques que vous écoutez… Ces gens sont des porte-paroles d’une contre-culture qui n’est pas (ou peu) diffusée par les médias traditionnels. Et qui n’est pas lucrative.
C’est un choix de passionné, pas une obligation. Mais reste que le journalisme metal est une activité qui demande dévouement, connaissance… et ponctualité.
Et si je vous parlais du concert, quand même ?
La ponctualité, justement. Revenons au lundi 4 novembre, sur les lieux du discret Espace B, dans le fin fond du Xxème arrondissement (?) où je ne peux m’empêcher de me surprendre : Dirge, déjà sur scène, finit les derniers réglages avant de commencer le concert quand je parviens à me faufiler parmi la foule - venue en masse pour nourrir sa passion pour le postcore ce soir-là.
Régulièrement, que ce soit pour le compte de Pelecanus ou d’autres publications, il m’a été impossible d’aborder le groupe de première partie lors d’un reportage. Pas par mépris, non. Simplement parce que je n’avais pas pu me rendre à temps au concert à cause de mes horaires de travail et de la désagréable habitude des organisateurs de faire commencer les concerts très tôt à Paris (“Bientôt, ça attaquera à l’heure du goûter”, comme m’a dit un jour Estelle de Pelecanus).
C’est donc bien l’une des raisons qui me font quitter cette activité : la frustration de ne pas accomplir le travail correctement s’ajoute à la déception de ne pas tirer sa publication vers le haut. De ne pas pouvoir la rendre irréprochable. De ne pas pouvoir être exhaustif alors même qu’on se rend, sans passer par la case “chez soi”, sans se changer, sans manger, au lieu du concert.
Les incompris
Reste que ce lundi 4 novembre-là, une fois n’est pas coutume, je participe à l’intégralité de la première partie choisie par Kongfuzi, soit le quartet parisien Dirge. Un groupe au statut étonnant, Dirge. Moitié génies, moitié pillards, si l’on synthétise. Ils sont régulièrement conchiés par une bonne partie du public post-metal de la capitale pour n’être qu’un simple copycat de Neurosis.
Heureusement, ils sont aussi reconnus par la critique pour porter les couleurs d’un certain metal 90s d’une très belle manière dans l’Hexagone. C’est noir et dense, typé postcore première génération, mais aussi racé et délicat comme le son d’une gigantesque machine industrielle dont les pauvres inventeurs auraient perdu le contrôle.
Fidèles à leur réputation, ils déroulent 50 minutes de metal gonflé de nappes de son s’ajoutant les unes aux autres, faisant ronfler les basses des enceintes et des amplis d’une douce façon. De nombreuses chansons sont issues d’Elysian Magnetic Fields, excellent disque qui illustrait deux ans et demi plus tôt mon gris paysage stéphanois - tant qu’à vous parler de moi.
Alcool 1 – journaliste 0
La tête encore pas vraiment vidée de mes responsabilités professionnelles du quotidien, j’ai du mal à me détendre. Difficile d’aborder la musique comme je le devrais et je m’en rends compte avec amertume. Eurêka. C’est de l’amertume qu’il me faut. Je trouve la solution en concentrant mes forces à vider ma pinte de bière. Bonne idée : je ne suis pas très gros. Et n’ayant rien mangé d’autre qu’un sandwich lors de ma journée, la Grimbergen pression se fait immédiatement capiteuse et la musique de Dirge, enfin, m’englobe.
Mission accomplie : le son de Dirge finit enfin par m’inonder tout entier sur la deuxième partie du set. Les râles de la basse, rampante et hypnotique, rythment avec le jeu fin du batteur le dodelinement de tête de l’audience. Ravageur, le son des guitares constitue un écrin de choix pour la voix rauque et vindicative du chanteur, la bouche déformée lorsqu’il crie, yeux fermés.
Dirge, royal, a donné un concert qui aura calmé tout le monde. C’est dommage, car il n’empêchera pas la rumeur de continuer à les traiter de “Neurosis parisiens”, un surnom qu’ils ne méritent pas. Dirge est Dirge. Et c’est déjà beaucoup.
Non, franchement, je préfère encore Envy
Me reste à vous raconter que Rosetta s’avère finalement presque aussi ennuyeux en live qu’en studio. Je n’ai jamais rencontré qui que ce soit se disant transcendé par leur musique. Bon, intéressé, tout au plus. Rosetta m’a toujours fait l’impression d’être un groupe correct, plutôt efficace, mais lisse et automatique au fur et à mesure des écoutes. Dans les articles que vous pouviez lire il y a quelques années, on appelait ça des “seconds couteaux”.
Et là surprise : Rosetta sauve la mise grâce à son chanteur, véritable frontman dans l’âme. Furieux et rageur, il éructe littéralement au visage d’Andrey, le photographe de Pelecanus dont vous pouvez admirer les photos concernant ce soir-là. Son regard dévisage chacun dans le public et c’est défiguré de colère plus que de tristesse qu’il hurle les paroles, crispé dans une attitude de guerrier au front. Pourtant, quelque chose me gêne.
Horna : varièt’/black metal
Dans le livre de Frederick Martin “Eunolie, Légendes du Black Metal”, on peut lire l’appréciation toute personnelle de l’auteur concernant le groupe Horna. Selon lui, la formarion de Black Metal fait progresser ses chansons sur des structures de musique pop, voire de variété. Et il n’a pas tort : les enchaînements type “la/fa/do/sol” sont curieusement légion. Pourtant, Horna jouit d’une réputation de groupe intègre autant qu’agréable, cher aux puristes. Pourquoi ? Grâce à tout le reste : leur production très raw, leurs accoutrements typiques du metal noir scandinave et leur dévotion à Satan. Très frais, Horna.
Rosetta fonctionne pareil, le talent en moins et le hardcore en plus. Alors qu’il développe un son parfois monolithique et sans pitié, les accords de la basse et de la guitare restent d’une simplicité affligeante, confinant la prise de risque hors de portée et ne faisant confiance qu’à des arrangements vus et revus. Oui, vous les connaissez ces fameux arpèges de guitare pompeux empruntés à Red Sparowes ou Envy. C’est ça, ceux qui progressent sur six ou sept longues minutes pour finalement s’alourdir de plus en plus, saturation oblige, vers des copies pathétiques de chansons de Cult Of Luna.
Rosetta, c’est un bon moment en concert, peut-être. Une demi-heure, du moins. Soit le temps que j’ai tenu dans la salle avant de passer mon ennui sur une cigarette, planqué sous le porche de l’Espace B. À l’intérieur, le groupe terminait le dernier tiers de son set sous les applaudissements d’un public conquis. Seul, je contemple ma propre indifférence générale.
Promis, c’est presque terminé
Voilà pourquoi j’ai toujours été conquis de l’importance de la presse musicale, dans son exercice d’indépendance et de critique. Pas pour traîner une nouvelle fois des résidents d’outre-Rhin dans la boue, ni pour encenser un groupe parisien. Mais pour transmettre, d’un point de vue de témoin averti, les tendances. Pour rendre compte d’où chercher le talent. Peut-être.
Contrairement à certains de mes confrères, je n’ai jamais fait ça pour mettre ma misérable petite personne en avant, ni avec pour seule motivation la gratuité aux concerts ou la réception - et la pratique est en voie de disparition - de CDs promo. Mais pour tenter d’éclairer le public, du (trop peu) haut de mes minuscules connaissances, vers des écoutes qui devraient lui convenir.
Parce que je vous l’affirme, ma propre vie a changé grâce à certains de ces artistes. Et j’ai découvert nombre de mes groupes favoris grâce à certaines personnes qui ont un hobby bizarre. Ça consiste à décrire une musique stridente chantée par des beugleurs satanistes, en gros. De l’importance de la presse musicale.
Car oui, la musique est subjective. Et non, je n’ai plus vraiment le temps de vous expliquer pourquoi.
Au revoir.
|
Affreux vilain metalhead incurable et rédac'chef |
À lire également
|
Playlist |
Retour sur |
Actualités |
|
Retour sur |
Rien à foutre à Paris ? |
Retour sur |






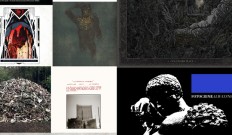





Ajouter un commentaire