Vous êtes ici
Kerridge, ou l'eschatologie musicale

Le nom Samuel Kerridge ne vous dit peut-être rien et pourtant, il y a en ses lettres l’annonce d’une fin du monde prochaine. Si l’on devait comparer la musique de l'artiste à une peinture, on choisirait L'Apocalypse d’Albrecht Dürer. Le jeune Britannique se présente à nous sans grande prétention, avec son corps longiligne étiré comme une perche et ses cheveux bruns négligemment plaqués sur son front. On ne peut véritablement pas le soupçonner de fricoter avec les puissances telluriques.
Le vendredi 21 février, le Glazart recevait en son antre le Balrog des platines. Une soirée aussi surprenante qu’intrigante sur le public qu’elle a attiré et l’effet qu’elle a eu sur lui. Pour qui connaît les sons associés au nom Kerridge, l’annonce de sa programmation en France pouvait très facilement déclencher une inondation dans la belle capitale. Remplissant des lieux aussi prestigieux que le Berghain à Berlin ou la Fabric à Londres, qu’on se le dise, l’honneur était pour nous.
Son album A Fallen Empire sorti en novembre 2013 était précédé de trois EP. En 2012, Auris Interna nous faisait déjà découvrir une techno plus sale que la lie de l’humanité. La violence industrielle qui émanait des quatre tracks était dès lors l’annonce de la brutalité bestiale de son album en gestation. Une sortie suivie de près par The Shadow That Melt The Flesh 1-4 et Waiting For Love 1-4 en 2013, tout aussi coléreux.
Écouter A Fallen Empire est un acte très personnel. Cette musique métallique, oppressante, presque claustrophobique, doit se vivre intensément ou ne pas se vivre du tout. Comme l’univers des monstres de HP. Lovecraft est clos par les mots qui le créent, toujours au service de l’horreur, du monstrueux et du lyrisme, la musique de Samuel Kerridge édifie elle aussi sa propre mythologie.
En arrivant au Glazart, j’attends impatiemment la folie libératrice des corps, la sueur d’une seule créature hideuse enfantée de nos chairs en transe. Stupéfaction, on est bien loin du compte. À deux heures de son live, Samuel Kerridge boit tranquillement une bière au bar du club déserté, clope à la bouche. Le lieu est seulement animé par une femme en une robe blanche, seule devant la scène, s’agitant gentiment sur les sons émanant des platines de Tinmaar. L’eschatologie sonore sera donc a priori pour un autre jour.
Pourtant, après quelques cigarettes et deux-trois bières, le Glazart se remplit peu à peu, mais on ne va pas se mentir, nous n'étions pas foule. Alors qu’intérieurement je traite les Français de suce-moelles sans goût, Kerridge prend place et commence son discours sur la fin des temps. Autant vous dire que cela est indescriptible et puissant, et que les personnes présentes ce soir-là ont certainement apprécié leur chance. Cette douloureuse traversée des tranchées que l’on ressent pendant l’écoute de l’album, nous l’avons prise dans chaque décibel à l’assaut de nos tympans sans protection.
Kerridge veut être le témoin de nos corps qui se libèrent des entraves conventionnelles sur les dancefloors, que l’on soit 10 ou 100. La moindre chose que l’on puisse dire, c’est que son pari est gagné. Les silhouettes s’agitent, s’énervent, elles sont submergées par le son omniprésent, un son dégénérescent aux effets libérateurs. Ici, ça pue le métal, on entend les chaînes des machines frappant violemment la surface dure des mécanismes déchus. Les pistons hydrauliques frappent et résonnent contre les murs humides. L’ambiance est délétère et le disloquement des matières électriques semble prendre fin.
Après cette heure de violence auditive et physique, nous sommes laissés là, fatigués et heureux, comme libérés d’une réalité n’appartenant plus qu’aux autres. Quand la musique s’arrête, nous ne sommes que les pantins béats d’un Satan aux allures d’enfant de chœur.
|
J'ai plus de films d'horreur vus à mon compteur que l'enfant fantasmée de John Carpenter et Dario Argento. J'aime écouter de la musique et en parler, surtout ici. |
À lire également
|
Chronique |



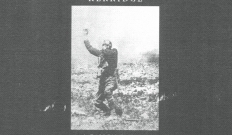
Ajouter un commentaire